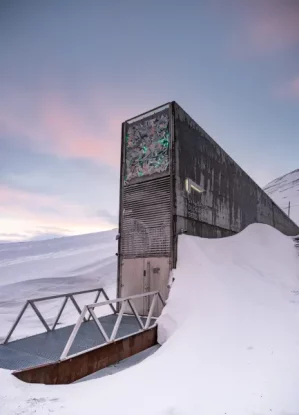Disponible ûˋgalement en anglais
Les forûˆtsô tropicales recû´lent une variûˋtûˋ de ressources prûˋcieuses considûˋrûˋes comme des ô¨ô biensô communsô ô£, comme le bois dãéuvre, le bois de chauffage et la viandeô deô brousse. Elles sont limitûˋes, partagûˋes avec tous, mais nãappartiennent û personne. Pourtant, lorsque les individus agissent uniquement dans leur propre intûˋrûˆt, ces ressources peuvent rapidement disparaûÛtre.
Quãest-ce qui peut donc convaincre les individus de les utiliser de maniû´re responsable et durable, et de veiller û ce que leurs pairs en fassent de mûˆmeô ?
Cette question est au céur dãune ûˋtude rûˋcente conduite par Arildô Angelsen et Juliaô Naime, scientifiques au Centre de recherche forestiû´re internationale et au Centre international de recherche en agroforesterie (CIFOR-ICRAF) ainsi quãû lãUniversitûˋô norvûˋgienne pour les sciences de la vie (Norwegian University of Life Sciences, NMBU).
Comme le savent toutes celles et ceux qui ont dûˋjû essayûˋ de couper un gûÂteau dãanniversaire, le partage des ressources implique un choix difficileô : dois-je me servir en premier ou dois-je penser aux autres et leur en laisser suffisamment pour plus tardô ? Ce dilemme est souvent appelûˋ la ô¨ô tragûˋdie des biens communsô ô£. Pourtant, comme lãûˋcrivent A.ô Angelsen et J.ô Naime, ô¨ô cette tragûˋdie nãest pas inûˋvitableô ô£.
En fait, apprendre û gûˋrer les biens communs de faûÏon responsable est et sera essentiel pour mener û bien les efforts de conservation û lãûˋchelle mondiale, tout particuliû´rement dans les zones rurales reculûˋes oû¿ les institutions formelles nãont pas toujours une portûˋe efficace.
ô Quand la sanction rencontre la coopûˋration
Pour que les groupes autonomes puissent gûˋrer durablement leurs ressources, deuxô ûˋlûˋments clûˋs sont nûˋcessairesô : un nombre suffisant de personnes optant pour des choix coopûˋratifs qui profitent û la collectivitûˋ, et des sanctions pour celles et ceux qui dûˋcident de ô¨ô profiter du systû´meô ô£ en prenant plus que leur part. Ainsi, la gestion communautaire des forûˆts repose sur ces mûˋcanismes pour ûˆtre efficace.
Nûˋanmoins, cãest ici que rûˋside le dûˋfiô : la sanction suscite souvent des rûˋactions nûˋgatives. Celles et ceux qui dûˋnoncent les profiteurs pour le bien de la collectivitûˋ risquent des reprûˋsailles, parfois sous la forme dãune vengeance directe de la part des personnes sanctionnûˋes, parfois de la part dãautres profiteurs qui ont ûˋchappûˋ û la sanction. Rappelez-vous û lãûˋcole lorsque rares ûˋtaient celles et ceux qui voulaient ûˆtre connus pour avoir dûˋnoncûˋ un camarade de classe. Une dynamique similaire se produit ûˋgalement chez les adultes, dûˋcourageant les personnes de sãexprimer pour la cause collective.

Expûˋriences de terrain dans troisô pays
Afin dãûˋtudier ces questions et de vûˋrifier si le contexte culturel avait une incidence, A.ô Angelsen et J.ô Naime ont menûˋ des expûˋriences encadrûˋes sur le terrain (EET). Il sãagissait de jeux de rûÇle interactifs avec des enjeux financiers rûˋels, oû¿ les rûˋsultats individuels et collectifs dûˋterminent les paiements pour services ûˋcosystûˋmiques (PSE). Les EET ont ûˋtûˋ menûˋes auprû´s de 720ô petitsô exploitants forestiers dans troisô rûˋgions riches en forûˆts tropicales communesô : ParûÀ au Brûˋsil, Kalimantanô central en Indonûˋsie et Ucayali au Pûˋrou.
ô¨ô Au cours de lãEET, un groupe de sixô utilisateurs forestiers locaux a ûˋtûˋ confrontûˋ û un dilemme social consistant û dûˋcider du nombre de parcelles û convertir pour lãagriculture û partir dãune forûˆt commune. La conservation forestiû´re procurait des avantages globaux plus importants au groupe sous la forme de PES collectifs, tandis que la dûˋforestation procurait aux participants des revenus agricoles supûˋrieurs û la perte individuelle des revenus issus des PESô ô£, ont expliquûˋ les coauteurs.
Les participants ont ensuite pris deuxô dûˋcisionsô : premiû´rement, le nombre de parcelles û convertir, puis, une fois les rûˋsultats obtenus, sãil fallait sanctionner les autres membres pour avoir converti trop de parcelles ou pour toute autre raison (lãidentitûˋ rûˋelle des autres membres nãa pas ûˋtûˋ communiquûˋe afin dãûˋviter des reprûˋsailles aprû´s lãexpûˋrience).
û partir de ces dûˋcisions, les scientifiques ont crûˋûˋ une typologie des acteurs. La sanction ûˋtait soit ô¨ô prosocialeô ô£ô ãô lorsquãelle visait les profiteursô ãô soit ô¨ô antisocialeô ô£, lorsquãelle visait celles et ceux qui coopûˋraient davantage.
La sanction prosociale ûˋtait gûˋnûˋralement motivûˋe par un souci dãûˋquitûˋ et dãûˋgalitûˋ de la part de celui qui sanctionnait, car elle rûˋduisait lãavantage supûˋrieur û la moyenne dont bûˋnûˋficiaient les profiteurs. En revanche, la sanction antisociale pouvait ûˆtre fondûˋe sur des sentiments de rancune ou de vengeance envers les pairs qui coopû´rent davantage. Les punisseurs antisociaux peuvent ûˋgalement tirer profit de la rûˋduction des gains des autres. Certains cas de sanction antisociale observûˋs dans lãEET peuvent avoir ûˋtûˋ des reprûˋsailles directes pour avoir ûˋtûˋ puni prûˋcûˋdemment.
Dans les troisô domaines de recherche, les chercheurs ont constatûˋ que les coopûˋrateurs et les punisseurs prosociaux (quãils ont surnommûˋs Homoô reciprocans) ûˋtaient le type de punisseurs le plus courant, tandis que les saboteurs (profiteurs qui se livrent ûˋgalement û des sanctions antisociales) constituaient le groupe le moins courant, avec environ 70ô % de sanctions prosociales et 30ô % de sanctions antisociales.
ô Inûˋgalitûˋs et disparitûˋs culturelles
ô¨ô Lorsque les ãmûˋchantsã commencent û punir les ãgentilsã, tout peut sãeffondrerô ô£ô
Pour comprendre les consûˋquences des inûˋgalitûˋs sur les sanctions infligûˋes par les pairs, les chercheurs ont menûˋ plusieurs expûˋriences dans lesquelles chaque participant disposait au dûˋpart dãun nombre ûˋgal de parcelles forestiû´res, et dãautres dans lesquelles ce nombre ûˋtait inûˋgal. Une proportion beaucoup plus ûˋlevûˋe de personnes a infligûˋ des sanctions dans les groupes inûˋgaux, ce qui indique ô¨ô la maniû´re ambiguû¨ dont les inûˋgalitûˋs affectent les schûˋmas de sanctionô : elles augmentent û la fois la proportion de sanctionneurs pros et antisociauxô ô£, ont soulignûˋ les auteurs.
Les sanctions par les pairs rendent le parasitisme coû£teux et les sanctions prosociales amûˋliorent les performances du groupe en incitant les surexploitants û rûˋduire leur conversion forestiû´re. Cependant, la part ûˋlevûˋe de sanctions antisociales, comme le montrent cette ûˋtude et dãautres ûˋtudes expûˋrimentales, rûˋduit lãefficacitûˋ des groupes autonomesô : ô¨ô Lorsque les ãmûˋchantsã commencent û punir les ãgentilsã, tout peut sãeffondrerô ô£, rûˋvû´le A.ô Angelsen.
Les chercheurs ont constatûˋ des diffûˋrences comportementales significatives en fonction des contextes culturels. Plus prûˋcisûˋment, les groupesô indonûˋsiens ont infligûˋ un nombre beaucoup plus ûˋlevûˋ de sanctions, en particulier des sanctions prosociales. Cela peut sãexpliquer par ô¨ô des normes et des prûˋfûˋrences plus fortes en matiû´re dãûˋgalitûˋ et dãûˋquitûˋô ô£ ainsi que par ô¨ô une plus grande acceptation du recours û la confrontation physique et verbale en cas de violation des normesô ô£ en Indonûˋsie par rapport aux deuxô pays dãAmûˋriqueô duô Sud, ont-ils soulignûˋ.
Dans lãensemble, les recherches montrent que les sanctions par les pairs peuvent ô¨ô donner des rûˋsultats en matiû´re de conservation et rûˋduire la dûˋforestation dans le contexte des PSEô collectifsô ô£. Cependant, les sanctions par les pairs peuvent ûˋgalement entraûÛner des rûˋpercussions nûˋgatives sur le plan individuel et collectif, qui doivent ûˆtre prises en compte dans les politiques de gestion des ressources communes. ô¨ô Lãauto-sanction par les pairs comporte un risque de comportement antisocial qui, outre son coû£t ûˋlevûˋ tant pour le sanctionneur que pour le sanctionnûˋ, a un effet nûˋgatif sur la coopûˋration futureô ô£, ont conclu les auteurs.
Remerciements
Cette recherche sãinscrit dans le cadre de lãûtude comparative mondiale sur la REDD+ menûˋe par CIFOR-ICRAF. Elle a ûˋtûˋ rendue possible grûÂce au soutien de lãAgence norvûˋgienne de coopûˋration pour le dûˋveloppement (Norad), du Dûˋpartement australien des affaires ûˋtrangû´res et du commerce (DFAT), de la Commission europûˋenne (CE), de lãInitiative internationale pour le climat (IKI) du Ministû´re fûˋdûˋral allemand de lãEnvironnement, de la Protection de la nature, du BûÂtiment et de la Sûˋcuritûˋ nuclûˋaire (BMUB), du Dûˋpartement britannique pour le dûˋveloppement international (UKAID) et du Programme de recherche du CGIAR sur les forûˆts, les arbres et lãagroforesterie (CRP-FTA), avec des contributions supplûˋmentaires de la part des donateurs du Fonds du CGIAR.